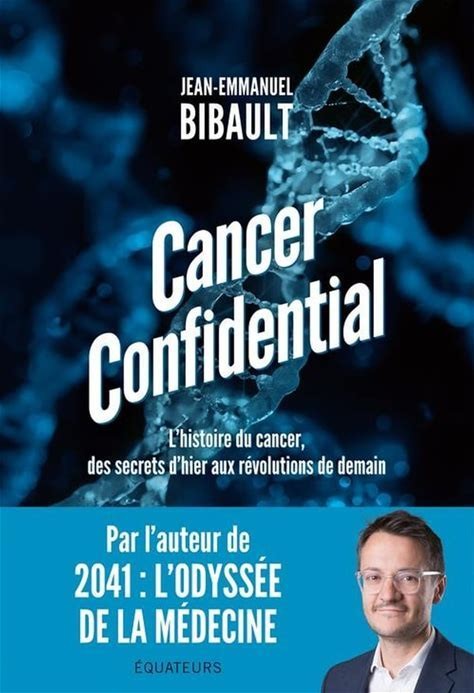À quand remontent les premières traces de cancer ? Quelles en ont été les premières formes ? Quels sont les premiers écrits ? À partir de quand a-t-on su diagnostiquer cette maladie ? Comment la compréhension de la maladie a-t-elle évolué au fil des siècles ? Quels traitements ont été tentés sur Anne d’Autriche, mère de Louis XIV atteinte d’un cancer du sein ? Comment a-t-on inventé la chimiothérapie ? Pour répondre à ces questions et bien d’autres, le Pr. Jean-Emmanuel Bibault – Oncologue radiothérapeute à l’Hôpital Européen Georges Pompidou et Chercheur en Intelligence Artificielle – a, à travers son nouveau livre « Cancer Confidential – L’histoire du cancer, des secrets d’hier aux révolutions de demain », remonté la piste du cancer, ce tueur à la capacité d’adaptation redoutable, de ses premiers méfaits à nos jours. Il a également retracé le long combat mené par les médecins et chercheurs pour trouver des traitements de plus en plus efficaces et espérer demain vaincre la maladie. Nous nous sommes entretenus avec l’auteur pour vous donner un éclairage de ce que vous pourrez découvrir au travers de cette « enquête scientifique ».
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire « Cancer Confidential – L’histoire du cancer, des secrets d’hier aux révolutions de demain » ? Et qu’est-ce qui vous pousse à écrire en général ?
Il y a une dizaine d’années, j’ai lu un livre américain « The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer » de Siddhartha Mukherjee. J’ai beaucoup aimé ce livre. Cependant, je trouvais qu’il donnait une vision très américano-centrée de l’histoire du cancer et des progrès qui ont été faits récemment en termes de traitements. C’est pourquoi, j’ai voulu, au travers de mon second livre « Cancer Confidential », apporter une vision plus française voire européenne de cette histoire. J’aime écrire pour des raisons créatives et aussi parce que j’écris beaucoup, sur le plan académique, d’articles de recherches etc. Ici, c’était plaisant de s’essayer à une écriture plus libre, à de la vulgarisation. Enfin, la raison pour laquelle j’aime bien écrire, réside aussi dans le fait que j’ai commencé à écrire pour mon premier livre, sur l’intelligence artificielle, qui a eu un bon succès. Donc je trouvais logique d’écrire un deuxième livre sur ma seconde spécialité qu’est l’oncologie.
Comment votre expérience en tant que radiothérapeute oncologue a-t-elle influencé votre écriture et les thèmes abordés dans votre livre ?
J’ai écrit ce livre pour aider les gens qui se posent des questions sur ce qu’est un cancer, sur comment on en est arrivé à la compréhension actuelle de la maladie.
Votre livre est un véritable voyage à travers le temps, couvrant plusieurs milliers d’années d’histoire. Quelles recherches avez-vous effectuées pour retracer cet historique et comment avez-vous intégré ces éléments historiques dans votre récit ?
Pour écrire ce livre, j’ai effectué un certain nombre de recherches historiques évidemment, et aussi biologiques. J’ai acheté des livres, j’ai lu beaucoup de publications scientifiques qui sont, bien que récentes dans l’histoire humaine, très anciennes dans l’histoire de la cancérologie. Le défi, pour moi, était de faire sentir, au travers de mon livre, cette sorte d’enquête « policière » qui remonte à 1,7 million d’années et va jusqu’à nos jours. Je souhaitais aussi documenter les progrès, très nombreux, qui vont arriver dans les prochaines décennies et qui vont permettre, je l’espère, de mieux traiter le cancer.

Quelles informations vous ont le plus étonné à travers vos recherches ?
Il y a une chose qui m’a fort surpris. J’en ai fait le thème d’un de mes chapitres. C’est l’histoire de la bataille des nazis contre le cancer. Je n’étais pas du tout au courant que les nazis avaient été aussi actifs sur cette thématique. Qu’un régime qui a commis de telles horreurs et qui, en parallèle, a mis en place des politiques qui ne sont pas très éloignées de celles que l’on a aujourd’hui, cela m’a interpelé. Ils ont instauré des campagnes, que l’on qualifierait aujourd’hui « marketing », contre le tabac, l’alcool, la consommation excessive de certains aliments, etc. ainsi que des campagnes de dépistage de certains cancers dans des centres de santé dédiés. Ces démarches m’ont fait poser des questions sur ce qu’était la limite acceptable de la prévention et d’une politique de santé publique. Ce qui est perturbant, c’est que toutes ces démarches faisaient partie de leur vision des choses, de la Grande Allemagne, d’une Allemagne pure. Où se situe la limite entre une sorte d’hygiénisme extrême et une prévention efficace ?
D’où vient le mot « cancer » ?
Le terme « cancer » est intéressant parce que, lorsque celui-ci est apparu, ce que l’on appelle aujourd’hui le cancer n’était pas vraiment considéré comme un cancer. On ne savait pas ce qu’était un gonflement ou une tumeur. Il a fallu attendre l’époque grecque pour voir émerger l’apparition et les facteurs qui favorisent l’apparition d’un cancer. Ainsi, le mot « cancer » vient du grec « karkinos ». Il est apparu à l’époque des grands médecins grecs qui avaient une théorie sur l’apparition de la maladie cancéreuse. Celle-ci résultait, selon eux, d’un déséquilibre entre nos quatre humeurs. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c’est que cela permet d’illustrer l’évolution de ce que l’on pensait être un cancer et de ce que l’on pensait être les facteurs favorisants de son apparition.

À quand remontent les premières traces de cancer ? Quelles en ont été les premières formes ?
Les premières traces de cancer ont été découvertes sur des dinosaures. Concernant nos ancêtres, c’est sur des hominidés que l’on en a découvert, au travers notamment de fouilles qui ont eu lieu en Afrique du Sud, où on a retrouvé, sur un tout petit os du pied, des traces d’un cancer assez rare qui est l’ostéosarcome. Même si à l’époque les gens ne vivaient pas très vieux, ils avaient déjà certains cancers. Cela illustre le fait que le cancer n’est pas uniquement une maladie réservée aux personnes âgées et que cette maladie a existé de tout temps.
Comment la compréhension de la maladie évoluera-t-elle ensuite à travers les siècles ?
On a une accélération de la compréhension à la Renaissance. C’est à cette époque que l’on a commencé à faire des dissections et à regarder sous microscope.
Quels sont les principaux défis auxquels les patients et les professionnels de la santé sont confrontés aujourd’hui dans la lutte contre le cancer ?
Il y a de nombreux défis auxquels nous sommes actuellement confrontés. Pour commencer, il y a le défi de la prévention qui passe par le dépistage. Dans la médecine moderne, on est assez mauvais sur le versant « prévention des maladies », dont le cancer, alors qu’en fait, il faudrait essayer d’axer nos actions surtout sur ce versant. Ce défi est compliqué parce que personne n’a envie d’avoir de maladies graves. Tout le monde a envie de vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Mais, en même temps, personne n’a envie de se priver de certains aliments, de certains toxiques comme le tabac, l’alcool, etc. On est dans une tension entre ces deux aspects, ce qui n’est pas toujours facile à concilier. Le deuxième défi, quand on a une maladie qu’on n’a pas pu prévenir, consiste à déterminer les traitements qui vont vous donner les meilleures chances d’en guérir avec le moins d’effets secondaires. Près de 4 millions de personnes vivent avec un diagnostic de cancer en France. Certains ont été guéris mais doivent vivre avec des séquelles qu’ils vont garder toute leur vie. Ces séquelles peuvent impacter lourdement la qualité de vie. Aussi, un des défis qui va venir, qui est déjà présent, c’est comment faire pour guérir les patients et que ceux-ci préservent une bonne qualité de vie.
Quelles sont les limites actuelles des traitements contre le cancer et comment pouvons-nous les surmonter ?
Avec les traitements dont on dispose aujourd’hui, on n’a jamais guéri autant de patients. Près de 40 % des patients sont en vie à 5 ans. On n’a jamais aussi bien guéri les cancers des enfants, pour lesquels on obtient 80 à 90 % de guérison. C’est vraiment encourageant. En parallèle, on peut ressentir comme une forme d’impatience du point de vue de la science pour avoir accès aux derniers traitements. On peut avoir parfois l’impression que la science ne va pas assez vite. Il y a une sorte de course contre la montre. Cependant, les traitements contre le cancer dépendent et découlent directement de la compréhension qu’on en a et donc de la science. On a parfois l’impression qu’actuellement il y a un petit recul de la science sur ce type de maladies avec l’apparition de traitements un peu ésotériques. Il est vrai que la mise au point de nouveaux traitements prend du temps, mais ce n’est pas une raison pour aller contre la science, de s’en détourner et de choisir des traitements qui sont, de toute évidence complètement inefficaces, parfois nocifs voire contre-productifs vis-à-vis des traitements qui eux fonctionnent.
Pouvez-vous nous parler des nouvelles technologies mentionnées dans votre livre qui révolutionnent actuellement le traitement du cancer ?
Il y a beaucoup de technologies qui vont arriver. Et l’intelligence artificielle va en être le grand chef d’orchestre.
Quels conseils donnez-vous aux patients et à leur famille pour faire face à un diagnostic de cancer puis au parcours de soin ?
Je pense qu’il faut avoir une approche réaliste, mais aussi de compassion et d’espoir. Il faut être conscient que, même si c’est une maladie qui est grave, je pense que le temps où cette maladie était vraiment stigmatisée, où on pouvait avoir honte d’avoir un cancer, doit être fini ! Il faut que la société l’accepte. Et il faut prendre conscience qu’on a des traitements qui n’ont jamais été aussi efficaces. Il y a de vraies raisons très concrètes d’espérer. Évidemment, quand on a ce genre de diagnostic, c’est toujours une mauvaise nouvelle, mais c’est sans doute moins une mauvaise nouvelle aujourd’hui qu’il y a 20 ans.

Quels sont vos futurs projets en matière de recherche sur le cancer ?
En termes de projet de recherche, au sein de mon laboratoire INSERM qui se situe au centre de recherche des Cordeliers à Paris, nous travaillons principalement sur des modèles multi-échelles. C’est-à-dire que l’on intègre différentes sources de données médicales pour créer des IA (intelligences artificielles) capables de parfaitement prédire, par exemple, le risque d’apparition d’une maladie ou, si on a une maladie, les chances d’en guérir en fonction des traitements que l’on utilise. J’ai, par ailleurs, créé récemment une startup qui s’appelle Jaide. Celle-ci est à la fois au service des patients et des médecins et a pour objectifs de faciliter et fluidifier les consultations médicales et d’en améliorer la qualité. Des essais ont été lancés dans cinq centres en France, avec des résultats qui, je l’espère, seront vraiment prometteurs en termes d’automatisation de certaines tâches techniques pour le médecin, qui peuvent prendre du temps et qui devraient être faites par une machine. L’idée ici – c’est un peu le point que je développais dans mon premier livre – est que l’IA doit être au service de l’humain comme un outil. L’IA doit être utilisée pour réhumaniser. On ne doit pas craindre à ce niveau une déshumanisation de la médecine. Celle-ci s’est déjà beaucoup déshumanisée sur les dernières décennies et l’IA peut aider à ce niveau.
Vous êtes médecin, chercheur, écrivain, père de famille. Comment conciliez-vous tout cela ?
Je ne vois pas cela comme des choses très distinctes. Je trouve au contraire que c’est très complémentaire. L’un nourrit l’autre, dans un sens ou dans l’autre. Donc tant que j’aurai le temps de faire tout ça, je le ferai. Et puis si un jour ça devient trop compliqué, j’arrêterai. On verra bien. Tant que c’est possible, je continue.
Qu’aimez-vous lire en général ? Quels livres recommanderiez-vous aux personnes qui sont dans un parcours de soin pour un cancer ?
J’aime lire les romans. Peut-être arriverai-je à en écrire un, un jour. Sinon, j’aime beaucoup le cinéma. D’ailleurs, j´aimerais beaucoup écrire un scénario de film. Pour les personnes qui sont en parcours de soin pour un cancer, je ne recommanderais pas forcément un livre médical. Je recommanderais plutôt un livre que j’ai relu récemment, à savoir « Les pensées » de l’empereur romain Marc Aurèle, qui s’inscrivent dans le stoïcisme. Celui-ci a été écrit il y a bien longtemps. Il n’était pas censé être publié. Ce sont des notes tirées du carnet de Marc Aurèle. Celles-ci ont été retrouvées a posteriori et ont été publiées, il y a quelques siècles. Elles sont devenues depuis un best-seller non démenti. C’est une source d’inspiration extraordinaire. Voilà ma recommandation actuelle. Pas très innovante, mais elle reste plus que jamais à l’ordre du jour.
Pour en savoir plus : Jean-Emmanuel Bibault – Oncologue radiothérapeute à l’Hôpital Européen Georges Pompidou et Chercheur en Intelligence Artificielle.
Cet article vous a intéressé ? Nous vous invitons à lire également l’article « Les bienfaits de la lecture sur la santé : les effets positifs des livres » : https://mesmomentsprecieux.fr/vivre-avec/les-bienfaits-de-la-lecture-sur-la-sante-les-effets-positifs-des-livres/